30 octobre 2019

Photos de Anais Vanel – Crédit : Stephane Bellocq
Anaïs Vanel a décidé de mettre quelques cartons dans le coffre de sa voiture, de quitter Paris et son métier d’éditrice pour s’installer près d’une grande plage des Landes. Elle s’y reconnecte avec la nature et avec son corps en pratiquant le surf, elle y vit sans télévision, sans internet, au rythme des saisons. Une nouvelle vie qui est aussi le terreau de l’écriture dont Anaïs rêvait et à laquelle elle ose enfin se consacrer. Roman de ce grand départ, de cette nouvelle vie mais aussi des souvenirs de l’enfance, Tout quitter se déroule par fragments avec la poétique des vagues, des saisons, des sensations.
Anaïs a accepté de nous parler de ce qui a accompagné ce grand changement de vie, du bonheur de s’ancrer dans le temps présent, de son acceptation d’un futur moins programmé et plus mystérieux, mais aussi de son rapport à l’écriture, de ses envies et de ses inspirations.
Anaïs, tu as quitté ton métier d’éditrice de bande-dessinées et ta vie parisienne pour t’installer sur la côte Atlantique, te reconnecter à la nature et à toi-même. Quel a été l’élément déclencheur de ce changement de vie ?
Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. Je ne veux pas véhiculer cette croyance qui prétend que tu te réveilles un matin en décidant que c’est fini. Ça n’est pas vrai. C’était en moi depuis des années. Il y avait un malaise que je n’arrivais pas à nommer, d’une part parce que je viens d’un milieu assez modeste et que ma carrière représentait une forme d’ascension sociale qui a joué sur le regard de ma famille, d’autre part parce que j’évoluais dans un milieu au sein duquel c’est ton statut social qui te définit. On est enfermés dans le mono-travail et on se dit que si on perd ce titre on ne sera plus rien, ce qui est terrible.
« J’évoluais dans un milieu au sein duquel c’est ton statut social qui te définit. On est enfermés dans le mono-travail et on se dit que si on perd ce titre on ne sera plus rien, ce qui est terrible. »
J’ai donc eu du mal à prendre ma décision. Je pense que les deux dernières années j’étais en « burn out », sans vouloir me l’avouer. Et j’ai encore du mal à le dire aujourd’hui parce qu’entre temps les médias se sont emparés du sujet et que je n’ai pas envie de m’inscrire dans un cliché qui ne me correspond pas. Il ne s’agissait pas d’un « burn out » comme ce qu’on voit à la télé, je n’avais pas la boule au ventre le matin, je n’étais pas tout le temps en train de pleurer le soir, mais j’étais dans une sorte de prison dorée, je n’étais pas moi, je jouais un rôle social. Et cela impliquait de boire beaucoup d’alcool, quasiment tous les soirs.
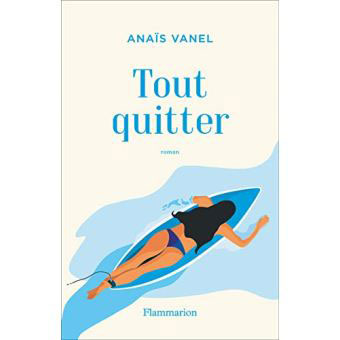
Oui, tu en parles dans ton roman, de cet alcoolisme social, dans lequel nous pouvons être beaucoup à nous reconnaître je crois.
A Paris, on ne s’en rend pas compte car tout le monde boit beaucoup. C’est de l’alcoolisme mondain mais c’est de l’alcoolisme quand même. C’est une consommation quotidienne pour tenir, pour se maintenir dans un rythme, comme la cigarette. Je n’avais pas rêvé d’une vie comme ça, mais un an passe, deux ans passent, douze ans passent, et tu ne te poses plus de questions, tu es dans ce rythme effréné et tu ne vois pas que tu es à côté de ta vie. A chaque fois que je revenais de vacances, je me disais qu’une autre vie était possible, puis j’oubliais.
« Je n’avais pas rêvé d’une vie comme ça, mais un an passe, deux ans passent, douze ans passent, et tu ne te poses plus de questions, tu es dans ce rythme effréné et tu ne vois pas que tu es à côté de ta vie. »
Mais, l’année précédent mon départ, j’ai fait un stage de surf avec mon frère au cours duquel j’ai vraiment lâché prise. On faisait du surf tous les jours et j’ai senti cette fatigue du corps, cette bonne fatigue des muscles, ces courbatures. J’ai senti ce qu’était la coordination des mouvements du corps dans un nouveau milieu et je me suis reconnectée à mon corps. Ça faisait douze ans que j’étais à Paris, que je faisais le même métier, et j’avais perdu cette curiosité, cette capacité d’émerveillement dans un milieu qui m’était complètement étranger car j’étais quelqu’un d’assez terrestre. A l’eau on est vraiment tous pareils, tous en combinaisons, on a tous l’air d’enfants en fait. Ça allait au-delà du surf pour moi, c’était la découverte du milieu marin, de l’océan, des courants, des marées, ça m’appelait, c’était formidable. Je me suis sentie vivante dans cet environnement et je me suis dit qu’il fallait que j’écoute ça.
Quand je suis rentrée, j’ai rééquilibré des choses, je me suis mise à faire du yoga, du sport, j’ai arrêté de sortir, de fumer. Pendant toute une année, j’ai vécu dans un autre rythme et ça a commencé à aller mieux. Je me suis installée dans une forme de compromis qui a fait que j’étais un peu perdue, parce que je me disais que je pouvais peut-être rester. Mais j’ai vite réalisé que ça ne suffisait pas.
Tu parles du surf, de ce lien que tu as retrouvé avec les éléments, l’eau, la terre. Tu racontes aussi dans ton livre que tu t’es réapproprié la notion du temps, en faisant le vide pour te remplir de nouvelles choses. Parlerais-tu d’aboutissement d’une quête de sens et de liberté ?
Je comprends ce questionnement autour de la quête de sens, mais pour moi, avant de trouver un sens, il faut se trouver soi. J’étais plus dans une quête de liberté que de sens, je me sentais enchaînée. J’avais bien sûr créé ces chaînes, je ne me victimise pas. J’avais besoin avant tout de retrouver mon propre rythme, d’être libre de retrouver le goût du temps que j’avais perdu de vue depuis des années. C’est pour cela que j’ai construit le livre en quatre saisons, pour montrer ce que c’était que de se réapproprier la notion du temps, les saisons qui s’écoulent, le rythme de la nature qui change.

Justement, qu’est-ce qui t’a donné envie de faire de cette expérience un livre ?
J’ai toujours voulu écrire. Mais à l’école on ne t’apprend pas qu’écrivain est un métier. J’ai fait des études d’arts appliqués, ensuite de lettres, puis de métiers du livre. J’ai tourné autour du pot puisque j’ai fini dans l’édition de bande-dessinées mais c’était toujours à côté. Quand je suis partie, j’avais une envie vorace d’écrire, c’était un besoin vital, c’était étroitement lié à mon départ, c’était un tout. J’avais envie d’écrire pour laisser une trace de cette expérience. Ce départ, ce vide, cette reconnexion à la nature, toutes ces découvertes, c’était lié au besoin de retrouver mes mots.
Dès le départ, j’ai écrit de manière organique, sans m’imposer de contraintes car je venais justement de retrouver une certaine liberté. Dans un premier temps j’ai beaucoup écrit, jeté beaucoup d’encre sur le papier, puis j’ai beaucoup structuré, puisque c’est un roman et non un journal. J’ai beaucoup travaillé, sculpté, parce que je voulais rendre compte des émotions fortes qu’on peut ressentir avec peu. Je me suis attachée à travailler l’écriture et la structure en ce sens, avec ces petits instantanés qui se suivent, qui sont soit dans le présent soit dans les souvenirs. Ce travail d’arrangement qui avait pour but que le livre soit facile à lire a, paradoxalement, été assez difficile. C’est pour cela que je me réjouis aujourd’hui quand des gens me disent qu’il y a une facilité à le lire et qu’ils le relisent.
Tes parents, ton frère, ton ancien amoureux… tu les évoques dans ton livre. Comment tes proches ont-ils réagi à ce changement de vie ?
Au moment où je suis partie, je n’étais pas en capacité d’exprimer avec des mots clairs ce que j’étais en train de traverser et vers où j’allais. Je me suis isolée, j’ai vécu tout ce processus seule, je n’avais pas envie d’échanger. Il y a donc eu de l’incompréhension dans mon entourage mais comme j’avais coupé les liens je le vivais plus facilement. Et avec ma famille ça a été l’explosion : je n’ai pas parlé à mes parents pendant un an. A la fin de l’écriture du livre, je suis retournée les voir, le temps avait fait son travail, j’étais prête. Ils ont lu mon livre, ils ont compris beaucoup de choses. Ma mère m’a envoyé un message très émouvant dans lequel elle écrivait ne pas s’être doutée d’à quel point ma vie à Paris avait été difficile pour moi. Tout ça a finalement enrichi notre relation.
Beaucoup de gens disent que c’est plus facile de partir tout seul. Je suis célibataire et je n’ai pas d’enfant, je ne peux pas comparer, mais si partir seule est plus facile logistiquement, cela reste un challenge psychologiquement. Je ne veux pas laisser penser que c’est facile de partir tout seul. J’ai traversé de gros moments de doutes, ça a été parfois extrêmement violent, parce que j’avais encore une certaine violence qui subsistait en moi.

As-tu rencontré d’autres personnes ayant comme toi décidé de changer de vie et de sortir du système ?
Au début j’étais dans une volonté de solitude, j’avais besoin de me retrouver moi. J’ai donc vécu seule pendant assez longtemps, ça m’allait bien, ça m’a permis de beaucoup écrire. Je n’ai jamais eu peur de la solitude, de ne pas me refaire d’amis, et au moment où ça a été nécessaire j’ai rencontré des gens, notamment grâce au surf. Là où je vis, il n’y a pas ce système de mono-travail, de carrière. Les gens sont plus dans l’instant présent, dans le fait de s’adapter au jour le jour. Et, forcément, j’ai aussi beaucoup attiré les gens qui comme moi ont changé de vie. On s’est trouvés.
Tu écris : « J’ai lu quelque part : « Ta nouvelle vie te coûtera ton ancienne. » Je me demande combien de vies j’ai déjà eues. Combien j’en aurai encore. » Quels sont tes projets et tes envies aujourd’hui ?
On grandit beaucoup avec l’idée qu’on doit choisir une mono-orientation. C’est une perspective assez triste, une pression qui est encore très présente aujourd’hui. J’ai des envies plus que des projets. J’ai beaucoup planifié dans mon ancienne vie et c’est quelque chose que je ne veux plus faire. Projeter des choses à un, deux, trois, quatre ou cinq ans, c’est impossible pour moi, parce que tu ne sais pas la personne que tu seras. Ce que je sais c’est que je veux continuer à écrire, en faire mon métier même si c’est compliqué d’en vivre. Quand je suis arrivée dans l’édition, j’entendais tout le temps que c’était un milieu bouché, et j’y ai pourtant fait carrière. Je n’ai donc pas cette peur.
J’ai aussi envie de voyager. Quand j’étais petite, on ne voyageait pas beaucoup, on avait peu de moyens. Plus tard, quand tous mes amis faisaient le tour du monde ou partaient en Erasmus, j’étais à Paris pour construire ma carrière.
J’ai aussi envie d’explorer la question de l’identité, probablement à cause de mon adoption. C’est une question que je n’ai pas beaucoup creusée parce que si je l’avais fait avant, je me serais écroulée. Je n’avais pas de fondation, j’étais encore trop fébrile. J’avais besoin de passer par cette première étape de construction.

Qui sont les personnalités qui t’inspirent ?
Pendant ces deux années, j’ai beaucoup fait le vide car j’avais besoin de me couper de toute forme de sollicitation extérieure. J’avais besoin de me « déculturaliser ». Je n’ai pas internet, pas la télé, j’ai vendu tous mes livres. J’ai pris un abonnement à la bibliothèque mais j’ai très peu lu parce que je voulais me reconnecter à mes propres mots. J’ai néanmoins gardé quelques inspirations qui m’apparaissaient essentielles. Des écrivains de la nature, comme Thoreau et son Walden ou la vie dans les bois.
Je suis aussi très inspirée par Karen Blixen, par sa vie, sa liberté pour l’époque. Elle a une façon sublime de parler de l’Afrique, on déguste chacun de ses mots. Je saute souvent des passages quand je lis, mais avec elle c’est impossible.
Les artistes peintres m’inspirent aussi beaucoup. J’ai lu une critique de mon livre dans laquelle on le comparait à une peinture impressionniste, faite de touches qui au début n’ont pas forcément de lien mais qui, à la fin, forment un tout cohérent. Ça m’a beaucoup touchée car j’ai un rapport très sensuel à la peinture.
Dubuffet m’inspire énormément, pour son travail sur l’art brut et son travail avec les enfants.
Quelle est la couleur dont tu aurais du mal à te passer ?
Le bleu. C’est un passage de mon livre. Pendant le stage de surf, je me suis rendu compte que ma vie manquait cruellement de bleu, alors que j’étais habitée par le bleu depuis l’enfance. C’est une couleur qui me fait vibrer, vraiment. Depuis deux ans je goûte chaque jour ce bleu de l’océan, du ciel, qui s’harmonise beaucoup avec le vert des paysages du Pays Basque dont je suis proche.
Le noir me parle aussi beaucoup, notamment parce que je suis très admirative de Soulages qui a travaillé le noir, le « noir lumière ». J’aime son œuvre, et la façon qu’il a d’en parler.
Retrouvez Anaïs Vanel sur

Par Laura / Elles racontent, Noir Mystère



